Sujet/questionnement :
Problème représentation et image déformée de la femme par la figure de la sorcière.
Cours 1 :
Texte 1 :
Figure de la sorcière et l’oppression des femmes à travers les siècles en raison de leur non conformité et comportements déviants. Origine et signification de la sorcière. Sa part d’importance dans les revendications féministes.
« Comment arrive-t-on à croire en l’existence de choses qui n’existent pas » = croyances sont propres à chacun et apportent du confort (trouver du raisonnement dans une situation illogique).
Texte 2 :
« Le problème de la représentation consiste à essayer de comprendre les différentes relations que nous établissons entre ce que nous croyons être la réalité et la façon dont nous nous représentons cette réalité. Représenter consiste à rendre perceptible et communicable ce que nous percevons mais aussi ce qui échappe à l’observation directe soit en lien avec ce qui nous affecte et constitue les données de l’imagination ou encore suivant ce que nous réussissons à généraliser et rationaliser. »
« La figure de la sorcière coïncide entièrement avec cet imaginaire commun et partagé où l’instrumentalisation de la rationalité aura eu pour effet de chercher à contraindre les femmes à l’assujettissement d’une part et d’autre part à libérer ce que Mona Chollet nommera «la puissance invaincue des femmes», véritable paradoxe.
« Du point de vue de la méthode, l’amateur et l’amatrice de philosophie menant une enquête sera très rapidement confronté.e à la nécessité de distinguer ce que nous avons l’habitude de croire vrai et naturel et le domaine des représentations avec tout ce qu’elles ont de contingentes même si elles nous aident à connaître et nous orienter dans la réalité. Il et elle seront aussi confronté.es à des situations où des représentations de choses inexistantes ont autant d’effet sur notre sensibilité que si elles existaient. »
« Si je crois à la vérité de ce type de représentations je pourrai même me retrouver dans une situation où j’agirai comme si le Sabbat des sorcières existaient en ressentant de l’angoisse et de la peur exactement comme si j’étais en présence du Diable. On voit bien, grâce aux histoires de sorcières, que ce que j’imagine, même s’il s’agit d’une fabulation, a des effets sur mes sentiments, mes actions et la connaissance objective de la réalité. »
« Vous serez invité.es à comprendre que la recherche de preuves concernant l’existence des sorcières au XVIe siècle est loin d’être évidente car elle repose essentiellement sur des témoignages de personnes ayant donné leur assentiment à un ensemble de récits. Pourtant, des femmes pour la majorité, seront jugées sur la base d’une recherche de preuves pour avoir commis des crimes de sorcellerie. Vous remarquerez aussi que le problème vient du fait que ces représentations sont interprétées de diverses manières: politiquement, moralement ou religieusement suivant un monde d’intérêts, de coutumes et d’expériences qui semblent loin de nous. »
Problème de la représentation = parfois bouleversé par l’imaginaire et croire que c’est la réalité. Représentation réelle ou non, = effets sur sentiments, actions, connaissances.

Texte 3 :
« Du point de vue de Dewey, nous pouvons nous demander si nous sommes affectés par les conséquences indirectes de la manière dont nous nous représentons la sorcière. N’y aurait-il pas un lien à faire entre la figure de la sorcière et la condition des femmes dans notre société? »
« Ce que nous jugeons banal quant à la figure de la sorcière, apparaissant dès la plus tendre enfance dans nombre de récits, renvoie peut-être à un ensemble de conséquences ayant une importance plus grande que ce que nous croyons. »
Interprétation du divertissement avec les histoires des sorcières. Conséquences indirectes représentation sorcière. Caractéristiques banales pouvant porter des conséquences majeures.
Cours 2 :
Texte 1 :
« Pourquoi la femme s’est-elle soudain changée en sorcière ? »
« Problème de la représentation qui consiste à confondre les images, les concepts, les théories ou encore les récits avec le domaine des choses dites réelles, vous devriez entrevoir que ce problème n’est pas sans relation avec votre capacité à imaginer et à rationaliser. »
« Capacité à traiter l’information provenant de l’usage de sens pour créer des choses qui n’existent pas. »
« À la puissane des images issues de notre imagination et qui finissent par constituer une sorte d’imaginaire commun s’ajoute le fail qu’il n’est pas rare de préférer le domaine de notre représentqation plutôt que la réalité plus factuelle s’appuyant sur l’observation. »
Corrompre la réalité par l’imaginaire = déformation image femme par imaginaire collectif de peur envers les sorcières. Ce même imaginaire corrompt les esprit et la rationalité, expliquant le manque d’humanité dans la chasse aux sorcières.


Texte 3 :
« Dans le contexte des civilisations grecques et romaines Circé et Médée étaient des magiciennes, pas des sorcières. C’est dans le contexte de la religion chrétienne que la figure de la sorcière se définit telle que se la représenteront les inquisiteurs et la démonologie. C’est tout le rapport entre le jeu des représentations et la transformation des institutions qui se dessinent ici. »
« Cette mise en opposition est extrêmement signifiante car deux représentations mythologiques opposées de la femme seront rassemblées sous la figure de la sorcière. C’est l’essence même du paradoxe que de faire tenir ensemble des sortes de contradictions. »
Paradoxe entre la vision de la femme et la figure de la sorcière : à l’une, on associe la beauté, le charme et la délicatesse ; à l’autre, la vilenie, la laideur. Pourtant, on les associe dans la création d’une figure de l’imaginaire collectif. Craindre le pouvoir des femmes.
Texte 4 :
« Présentée ainsi il est difficile de ressentir l’angoisse qui découle de la tension entre le pêché et la rédemption. »
« Il nous manque entre autre, pour bien comprendre les effets de la morale chrétienne, la croyance en la présence du diable, l’effet de la tentation à commettre le mal lorsque nous exprimons des désirs. »
« Dans la religion chrétienne l’humain, le générique utilisé étant l’Homme (ceci n’est pas sans signification) est libre de commettre le pêché donc de choisir le mal. Ce sera le cas d’Adam qui acceptera la pomme offerte par Ève. »
« Il importe aussi de voir et réfléchir à l’évolution de la figure du diable comme le montre Colette Arnould de manière à poursuivre la réflexion en tenant compte des transformations sociales, celles impliquant les manières de penser ainsi que tout ce qui renvoie au domaine des représentations. La figure de la sorcière est indissociable de celle du diable dont l’univers symbolique est en constante transformation. »
Péchés, tentations et soumission aux désirs = la femme est vue comme la personnification du diable en incitant les hommes, par son physique et par sa personne, à commettre le péché.

Représentation de la figure du diable sous l’apparence de la femme.
Texte 6 : Résumé :
« L’auteure nous invite à prendre en considération le développement de la rationalité comme étant ce qui aura permis à l’humanité de sortir de l’univers irrationnel des superstitions. Cette thèse est généralement admise, mais il importe de la nuancer en comparant la manière de penser fortement influencée par la science aristotélicienne à celle issue de la science galiléenne qui constitue le socle de notre exploration moderne des lois de la nature. »
Cours 3
Texte 1 :
«À une vision misérabiliste de la condition de la femme au Moyen ¸Âge – une victime impuissante de la brutalité masculine – qui conforte, en fait, le discours, longtemps dominant, sur la nature faible et passive de la femme, a succédé, dans les travaux les plus récents, une autre image de celle-ci : un être qui n’était ni sans défense ni sans pouvoir. S’il en était autrement, comment comprendre l’acharnement des hommes contre des créatures si inoffensives?»
-Armelle Le Bras-Choppard, Les putains du diable
« Ces deux citations montrent bien qu’il ne va pas de soi de comprendre le Moyen-Âge et plus particulièrement la place qu’y occupent les femmes. D’une part parce que la société féodale ne fonctionne pas du tout comme la nôtre et d’autre part parce qu’une certaine forme de patriarcat semble avoir investit l’écriture de l’Histoire elle-même. »
Place de la femme durant le Moyen-Age sous un patriarcat imposant. Acharnement, bataillles.
Texte 3 :
« Mais c’est merveille, que pensant faire quelque grande horreur à des filles et des femmes belles et jeunes, qui semblaient en apparence être très délicates et douillettes, je leur ai bien souvent demandé, quel plaisir elles pouvaient prendre au sabbat, vu qu’elles y étaient transportées en l’air avec violence et péril, elles y étaient forcées de renoncer et renier leur Sauveur, la sainte Vierge, leurs pères et mères, les douceurs du ciel et de la terre, pour adorer un Diable en forme de bouc hideux, et le baiser encore et caresser ès plus sales parties, souffrir son accouplement avec douleur pareil à celui d’une femme qui est en mal d’enfant : garder, baiser et allaiter, écorcher et manger, les crapauds : danser en derrière, si salement que les yeux en devraient tomber de honte aux plus effrontées : manger aux festins de la chair de pendus, charognes, cœurs d’enfants non baptisés : voir profaner les plus précieux Sacrements de l’Église, et autres exécrations, si abominables : que les ouir seulement raconter, fait dresser les cheveux, hérisser et frissonner toutes les parties du corps : et néanmoins elles disaient franchement, qu’elles y allaient et voyaient toutes ces exécrations avec une volupté admirable, et un désir enragé d’y aller et d’y être, trouvant les jours trop reculés de la nuit pour faire le voyage si désiré, et le point ou les heures pour y aller trop lentes, et y étant, trop courtes pour un si agréable séjour et délicieux amusement. Que toutes ces abominations, toutes ces horreurs, ces ombres n’étaient que choses si soudaines, et qui s’évanouissaient si vite, que nulle douleur, ni déplaisir ne se pouvait accrocher en leur corps ni en leur esprit : si bien qu’il ne leur restait que toute nouveauté, tout assouvissement de leur curiosité, et accomplissement entier et libre de leurs désirs, et amoureux et vindicatifs, qui sont délices des Dieux et non des hommes mortels. »


Texte 4 :
« Afin de nous aider, nous pourrions comprendre ce processus à partir d’un autre domaine d’expression des rapports de force que l’homme établira avec la Nature elle-même. (Attention il est bien dit l’homme!) Effort de domestication, de maîtrise et de contrôle de la Nature grâce à l’usage de la Raison, grâce aux outils propres à la pensée rationnelle, l’instrumentalisation des connaissances, la puissance de l’abstraction mathématique, l’élaboration du droit etc. Toutes formes d’appréhension et de représentation de la réalité favorisant le développement d’un regard portant sur le monde extérieur empreint d’objectivité. »
« Avec l’avènement de la science moderne, il y a affranchissement des dogmes de l’Église, comme le montre notre auteure, les explications scientifiques n’ont plus à coïncider avec le plan divin. C’est par l’usage de la Raison que seront percés les mystères de la Nature. De la même manière qu’on assiste au passage de la foi à la loi, on retrouve ici un passage similaire d’un ensemble de vérités révélées dans le contexte de la religion à l’idée que la connaissance de la vérité repose sur l’usage de la Raison, la démarche scientifique et la souveraineté de l’esprit. »
« Si la science a cherché à comprendre la Nature objectivement quel est le problème dès lors que la femme est associée au domaine de la Nature? »
Moins désir de comprendre notre monde sous l’influence de l’imagination par la Raison.
Texte 5 :
« D’où le transfert de la lutte des pouvoirs vers une lutte entre les genres, l’instauration du patriarcat et l’assujettissement des femmes. D’où leur association au domaine de la Nature et leur enfermement dans la domesticité pour être réduite à la reproduction de travailleurs. Ce à quoi aurait servi la chasse aux sorcières caractérisant le passage de la féodalité au capitalisme. »
Renforcement du système patriarcal en détruisant le pouvoir des femmes. Suprématie de la masculinité sur le corps féminin = objectification
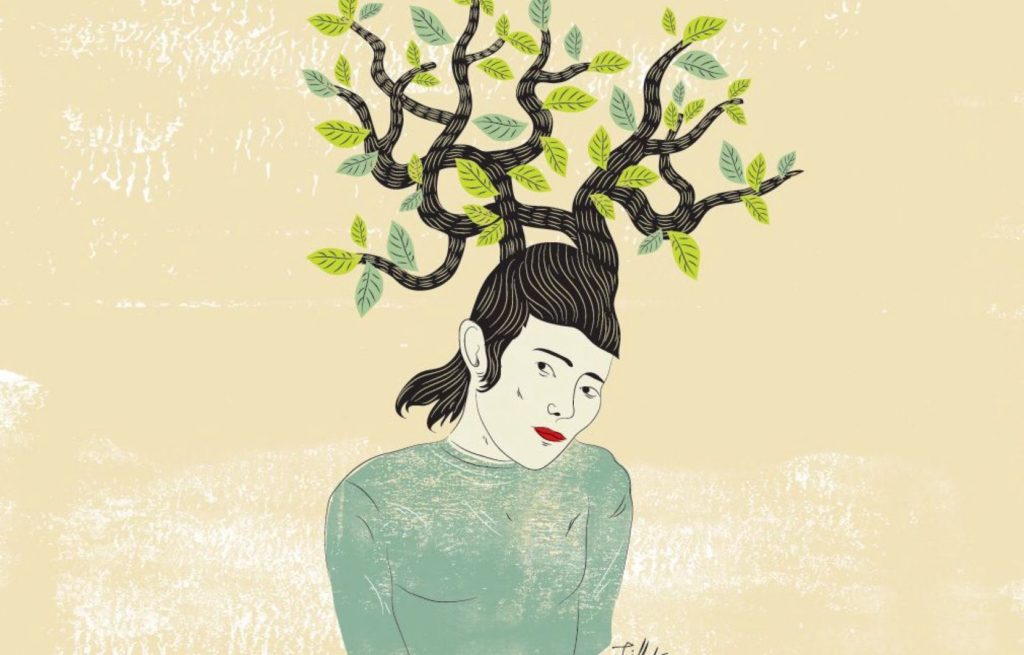
Première séparation entre la femme et son corps = obligation de procréer. Tentation de contrôle de la femme en interdisant/banalisant les actes à caractère sexuel autres que la reproduction.
Texte 6 :
« La lecture de l’histoire de la chasse aux sorcières généralement admise consiste à affirmer que la mise au bûcher des sorcières aurait cessé grâce à l’avènement de la rationalité. Or les auteures que nous avons lues montrent que la violence des répressions faites aux femmes a augmentée plutôt que diminuée avec l’émergence de la modernité comprenant la souveraineté des États, l’Humanisme de la Renaissance, le rationalisme scientifique, le capitalisme et le Droit. »