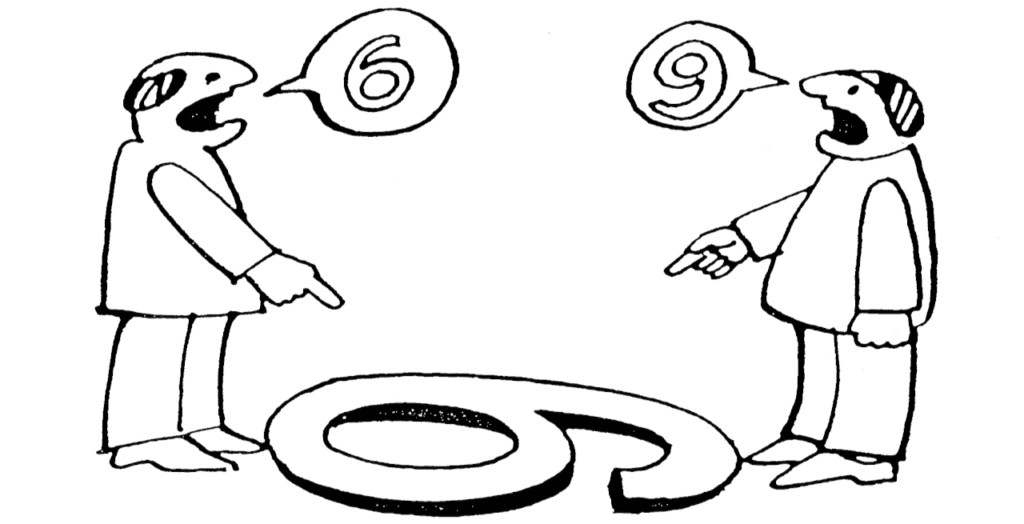
Journal d’enquête
RÉFLEXION PERSONNELLE
Côté philosophique de la perception…
D’un côté philosophique, la perception est un concept qui permet à l’être humain, à l’aide de ses sens, d’évaluer, de donner l’impression de, mais surtout d’offrir des significations. La perception est en constant combat entre l’évaluation psychologique de l’homme et du réel. En effet, elle permet d’offrir une compréhension ou une idée qui peut être plus ou moins concrète, mais qui laisse tout de même une empreinte dans la définition que l’individu lui associera.
Côté psychologique de la perception…
D’un côté psychologique, les concepts mentionnés plus haut deviennent très intéressants (impression, signification, évaluation, etc…). À cet égard, il est important de se pencher sur les effets de la perception et des phénomènes psychologiques qui en découlent.
Prenons l’exemple de : « Effet de Halo », voici sa définition :
« L’effet de halo se produit lorsqu’une première impression basée sur un seul trait d’un objet évalué est généralisée à d’autres aspects, parfois non reliés, de cet objet. Ce biais cognitif se manifeste lorsque les individus jugent rapidement une personne en se basant sur les impressions favorables ou défavorables d’une de ses caractéristiques1. »

Prenons l’exemple de la chasse aux sorcières qui illustre parfaitement le phénomène (Effet de Halo) :
Contexte historique…
Comme nous l’avons vu dans le cours, la figure de la sorcière est unie à l’époque du Moyen-Âge dans un imaginaire collectif, contrairement à la flambée des bûchers qui date plutôt de l’époque moderne. À l’époque du Moyen-Âge, la naissance des premiers procès, contre la science qui se penche sur les démons, allume une certaine agitation dans l’esprit des gens de cette époque. En raison de cet affolement, la sorcellerie était donc considérée comme un crime et c’est ainsi que la chasse aux sorcières à débuté. Cependant, la question qui se pose, dans ce contexte historique, est la suivante :
Pourquoi les femmes sont-elles plus visées par cette chasse ?
C’est ainsi que la pertinence de la perception et des concepts mentionnés plus hauts prennent encore plus de sens. La perception de la femme et de l’homme à l’époque n’était aucunement égalitaire (phénomène toujours actif, mais qui se présente sous différentes formes avec différentes intensités). En effet, la femme était perçue comme un être inférieur à l’homme, ce qui générait des idéologies et également des systèmes politiques (par exemple : le patriarcat) basées sur le domaine de la supériorité. Dans un même ordre d’idées, la figure de la sorcière est donc devenue une représentation de la femme dans les sociétés, se généralisant en fonction des préjugés qui se sont formés sur celles-ci. Il s’agit d’un processus très spécifique. En effet, tout ce phénomène débute à partir des interprétations que les sociétés se sont faites des femmes, interprétations qui ont découlé de suppositions et d’hypothèses. Les conséquences du chemin entre l’interprétation jusqu’à la signification est très significatif puisqu’il amène à former des représentations, qui elles, découlent à l’assujettissement de la femme.

QUESTIONNEMENT (TENTERA DÊTRE RÉPONDU À L’AIDE DE LA DISSERTATION)
À l’aide de la réflexion précédente, un questionnement s’est réveillé en moi :
« Dans quelle mesure les représentations contemporaines et modernes de la femme, souvent façonnées par des préjugés et des stéréotypes, participent-elles à un assujettissement subtil mais persistant dans notre société actuelle ? »
J’utiliserais le film Barbie, sortie en 2023, afin de faire l’exploration de cette question. Ce film qui tente, selon moi, d’offrir un place à la femme, mais qui en revanche, réussi tout de même à finalement se concentrer simplement sur l’homme.
Exemple d’exploration :
- Bien que le film tente de donner une voix aux femmes, il existe des moments où l’intrigue se concentre sur les expériences masculines. Cela permet d’examiner comment, même dans des récits qui semblent pro-féministes, les structures patriarcales peuvent encore influencer la narration et être mises en avant, alors qu’une image contraire était censée être valorisée dans le film. Un peu ironique, n’est-ce pas ?

La proposition de ce film est riche en intentions, mais ce qui se cache derrière cette surface l'est encore davantage, en lien avec la question centrale de ma dissertation.
- Comeau, C. (2021). Effet de halo, trad. S. Maillé. Dans C. Gratton, E. Gagnon-St-Pierre & E. Muszynski (Eds). ↩︎