Lorsque les Français sont arrivés, ils n’ont pas su accueillir les différences de manière bienveillante, préférant juger les autochtones en fonction de leurs propres critères. La technologie était associée au progrès, tandis que pour les autochtones, l’habileté, la liberté et le respect mutuel étaient les principales preuves de réussite. La religion catholique a diabolisé les rituels autochtones, qui en réalité étaient des cérémonies de connexion avec la nature. Les autochtones ont trop souvent été étiquetés comme « primitifs », alors qu’en réalité, leur société avait développé des compétences pour vivre habilement et en harmonie avec la nature, sans se laisser emporter par l’abondance des cultures colonialistes.
Les mythes communs
« Sauvages »
Les Français sont arrivés, ont étouffé la culture autochtone et ont pollué leurs terres et rivières. Ainsi, la question se pose : qui sont véritablement les « sauvages » ? Ceux qui protègent la nature et vivent en harmonie avec elle, ou ceux qui la détruisent au nom du progrès ? Le mot « sauvage » devrait d’abord évoquer la liberté en communion avec la nature, mais les français ont radicalement modifié la signification. Cette double vision du mot sauvage prouve à quel point les mythes communs teintent nos esprits et nos principes.
Voici un balado portant sur le mot sauvage qui a guidé ma réflexion:
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire
« Civilisation »

La culture palpable et tangible des autochtones s’est fait étouffé par les mythes communs abstraits de la culture colonialiste. Par exemple, leur concept de civilisation : ce mot a trop souvent été utilisé pour établir une hiérarchie entre les sociétés, en plaçant la culture occidentale comme le modèle ultime de civilisation, tandis que d’autres cultures étaient souvent dénigrées comme étant « moins civilisées » ou « barbares ». Cette notion de civilisation a été historiquement utilisée pour justifier le colonialisme. Pour décolonialiser le mot « civilisation », il est important de reconnaître que chaque culture a sa propre richesse et sa propre contribution à l’humanité. Par exemple, ce n’est pas parce que les autochtones ne bénéficiaient pas de diplômes français qu’ils n’étaient pas éduqués. Car, contrairement aux normes sociales françaises, le diplôme n’était par attesté par un papier accroché au mur, la reconnaissance académique n’était pas matérialisée pour les Autochtones. Leur savoir réside dans leur esprit, non dans des certificats.
Reconnaissance
Actuellement, les peuples autochtones se retrouvent emprisonnés dans un système de pouvoir fondé et justifié par ces mythes communs. Coincés dans cette situation complexe, ils se voient contraints de demander la reconnaissance de l’État canadien, un geste qui, implicitement, consacre la légitimité de cet État colonisateur. En conséquence, le débat est structuré d’avance, déjà établis dans nos racines et nos inconscients, limitant ainsi la marge de manœuvre des revendications autochtones. L’analyse approfondie de ces mythes n’a pas pour objectif d’effacer ou de marginaliser une culture au profit d’une autre. Au contraire, elle vise à instaurer une reconnaissance réciproque. Cette reconnaissance mutuelle permettrait d’éviter que notre société soit façonnée et influencée par des préjugés personnels ou des récits préétablis, tout en respectant et en valorisant chaque culture.
En accordant une pleine reconnaissance à la culture de l’autre, il deviendrait ensuite possible d’en faire abstraction pour parvenir à une réflexion plus objective, moins altérée par des perceptions déformées. Cette approche ouvrirait la voie à une détermination plus éclairée et rationnelle des droits fondamentaux, dépassant les barrières culturelles ou les récits historiques préexistants. Dans une société où l’arrivée des Français a suscité des conflits culturels et des injustices envers les peuples autochtones, il est crucial de reconnaître les implications de ces événements historiques dans la construction actuelle de notre monde. Les différences entre les cultures européennes et autochtones ont été mal interprétées, souvent réduites à des jugements basés sur des critères occidentaux, perpétuant ainsi des préjugés et des stéréotypes qui persistent jusqu’à nos jours. La diabolisation des pratiques autochtones, la hiérarchisation des sociétés en fonction de la civilisation occidentale et la marginalisation des connaissances autochtones sont des exemples frappants des préjugés perpétués par les mythes communs façonnant nos sociétés.
Parallèle entre la reconnaissance et le contrat social.
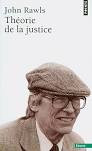
John Rawls, philosophe politique, a évoqué l’idée d’un contrat social juste et équitable entre des individus libres et égaux. Cependant, l’histoire des autochtones au Canada révèle une rupture fondamentale de ce contrat social initial, où ces peuples ont été privés de leurs droits sur leur propre territoire, confrontés à la nécessité de revendiquer des accords avec un pouvoir qui s’est auto-proclamé. Pour avancer vers une société plus juste, il est primordial de reconnaître et de déconstruire ces mythes communs qui continuent d’exercer leur emprise. La reconnaissance mutuelle des cultures, la valorisation de leurs richesses respectives et la décolonisation des concepts tels que la civilisation sont essentielles pour établir un terrain d’entente plus équitable. En reconnaissant et en se sentant reconnu par l’autre, il deviendrait possible de faire abstraction de sa culture et de ses récits communs quand il est temps d’adopter un mode de penser impartial et rationnel.
L’approche défendue par Rawls, prônant une équité entre les individus, résonne profondément dans la nécessité d’une reconnaissance authentique des cultures pour une société réellement juste et égalitaire. Ainsi, nous pourrons créer un nouveau contrat social plus inclusif, où chaque culture est valorisée, respectée et où la reconnaissance mutuelle prévaut, ouvrant la voie à une société où les droits fondamentaux sont déterminés de manière éclairée et juste pour tous.