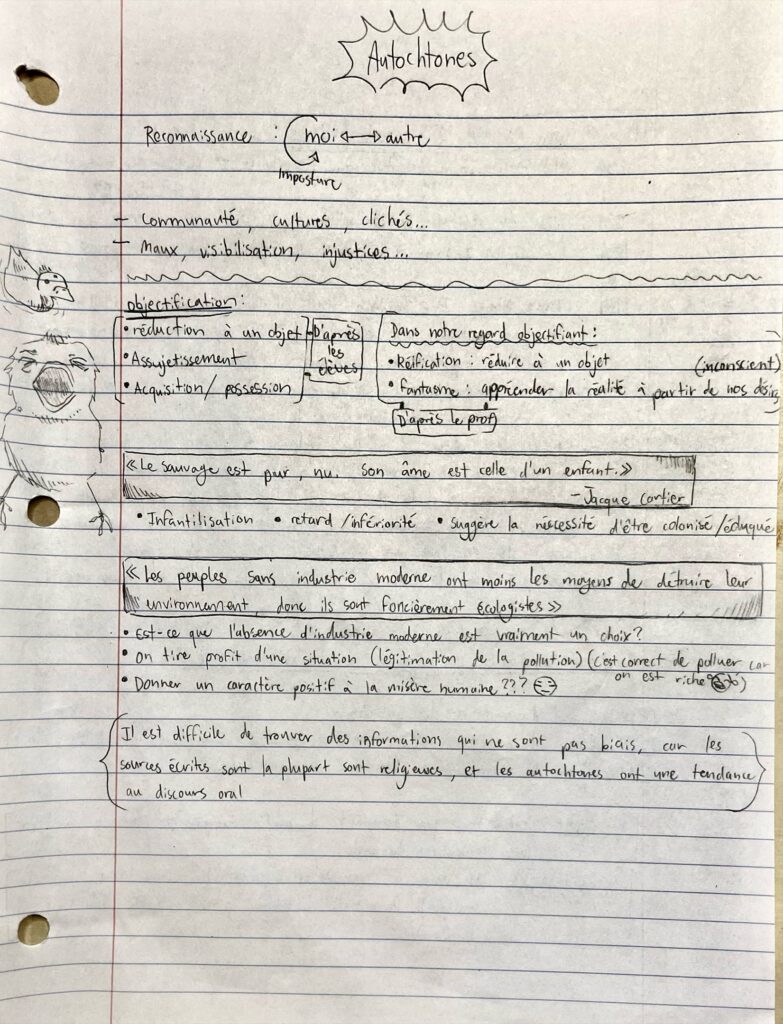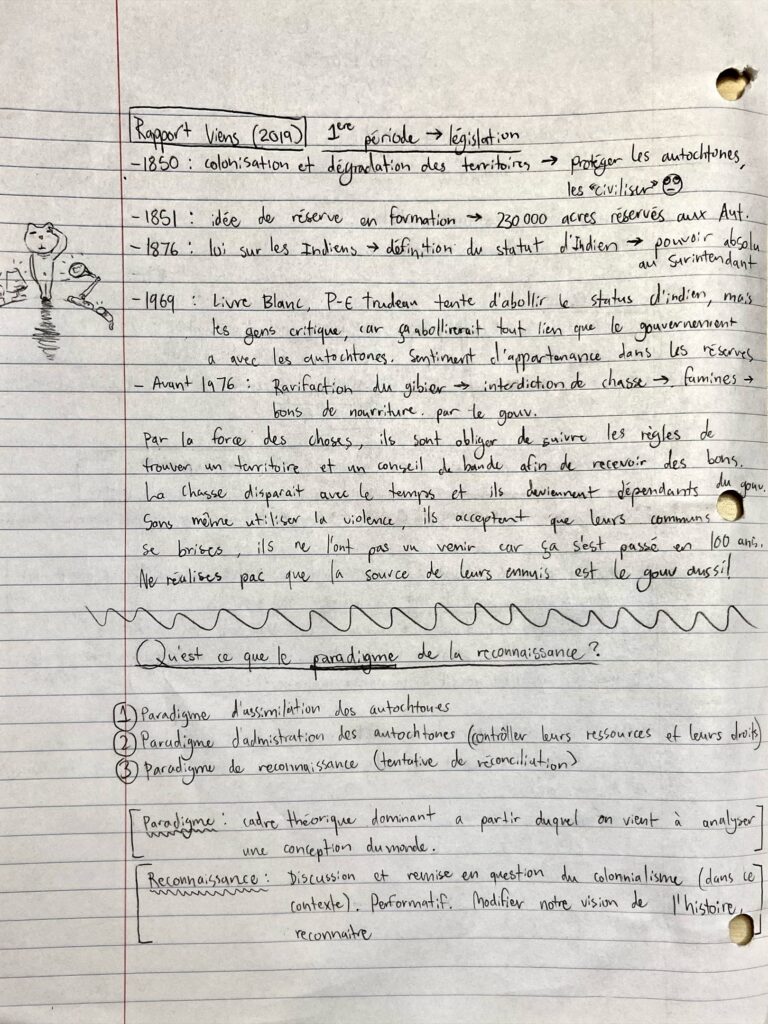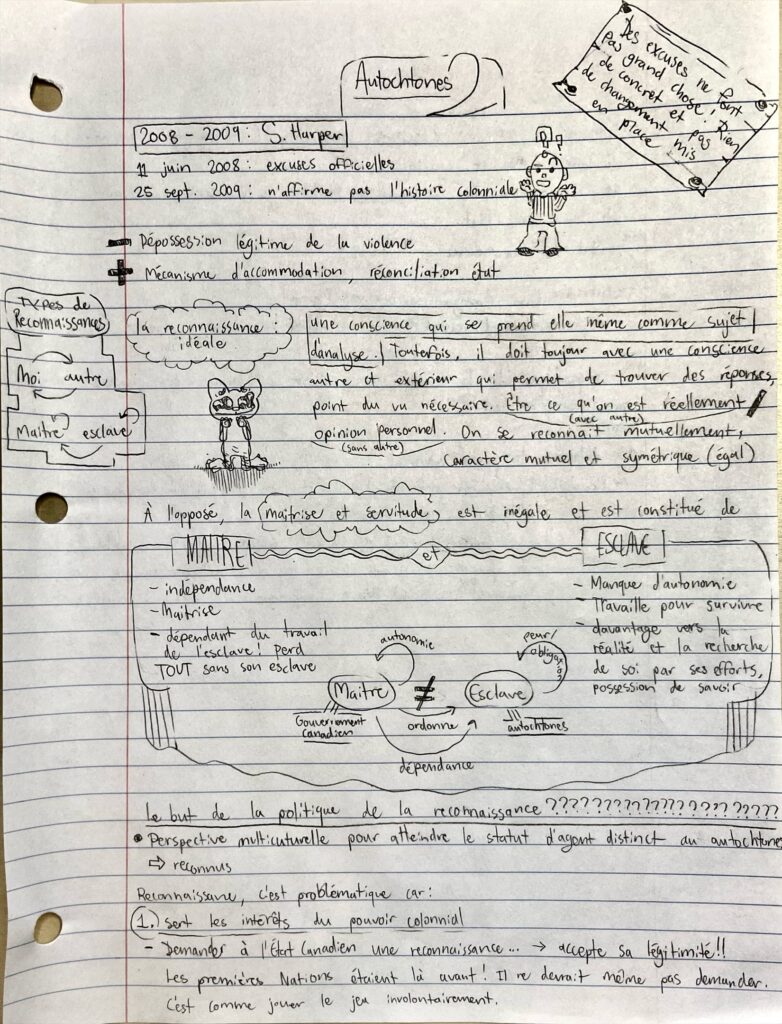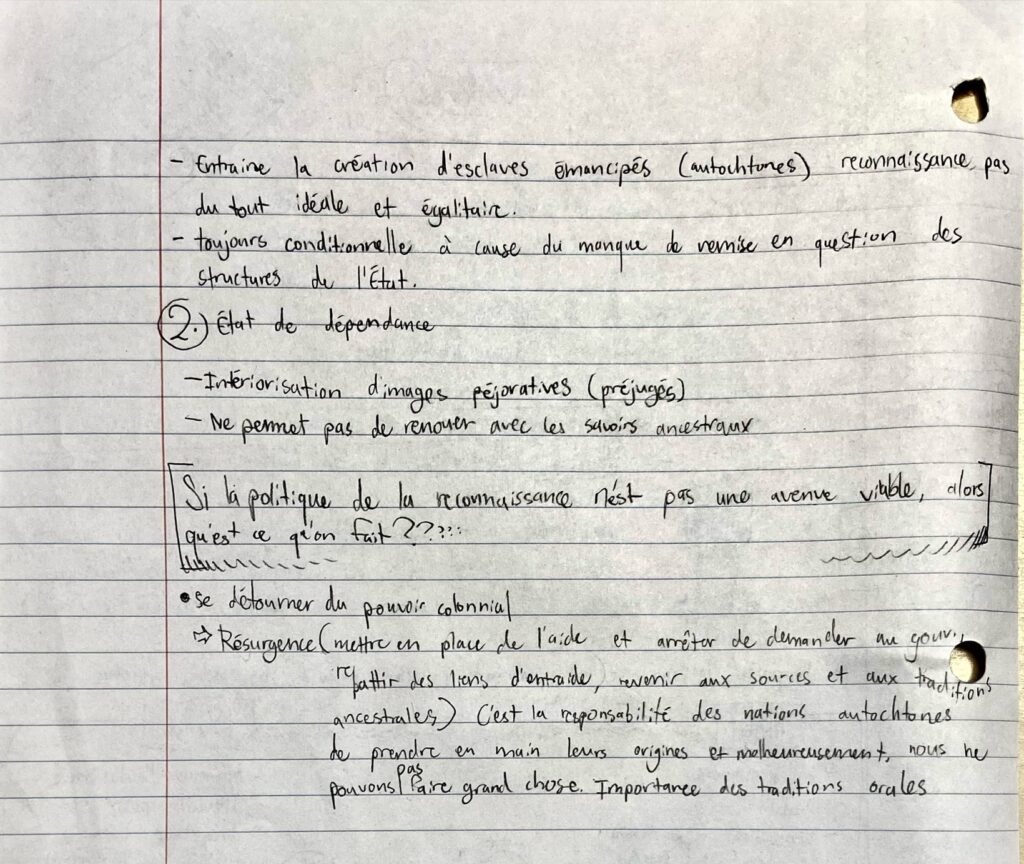En 1850, les colons blancs, qui s’étaient invités à l’insu des autochtones sur leur territoire, décident qu’il est temps de les rééduquer à leur manière. Les coutumes, les traditions et même les simples comportements des autochtones ne leur plaisent pas. D’après eux, ils sont sauvages, malpropres et méritent de l’aide comportementale. Plusieurs atrocités vont ensuite avoir lieu afin de les «civiliser», telles que la destruction de leur territoire, la maltraitance physique, la rééducation de leurs enfants, et bien d’autres ; un vrai génocide culturel. Tout cela, je l’ai appris beaucoup trop tard, et qu’en partie! En effet, au primaire nous apprenons très peu sur l’histoire de notre pays et les horreurs pratiquées autrefois. On ne parle que de tribus et de maisons longues… Même au secondaire, les ressources sont minimes et il en manque des bouts. Un changement au programme de l’éducation ne fut mis en place que très récemment et je trouve cela décevant. Cette partie de nos origines fut cachée très profondément par les autorités afin de l’oublier, mais ce n’est pas juste pour les autochtones, qui ne demandent qu’à être écoutés. Leur culture n’est qu’un tas de miettes à présent, qu’il faudrait reconstituer. Malheureusement, je crois que l’aide des Blancs ne serait qu’encore plus destructrice et que les autochtones vont devoir se rebâtir eux-mêmes. Toutefois, est-ce même possible? Leur culture fut-elle exterminée dans son ensemble ou a-t-elle encore un petit peu de forces pour survivre?
Lors de cette session, en cours de littérature québécoise, mon groupe a eu la chance de lire le livre Je suis une maudite sauvagesse d’An Antane-Kapesh, édité et préfacé par Naomi Fontaine, et traduit par José Mailhot, nous permettant de le lire en langue française. C’est un récit autobiographique originalement rédigé en innu, racontant l’histoire de son autrice qui fut témoin en temps réel des atrocités commises contre la communauté autochtone. Sa lecture est plutôt troublante. Nous apprenons enfin ce qui s’est passé réellement à cette époque, avec un point de vue concret, immersif et rafraîchissant en comparaison avec ce qu’on pourrait apprendre dans une salle de classe, par exemple. Dans les écoles, nous apprenons l’existence des pensionnats, mais il y a tant d’autres souffrances que cela. Jamais je n’aurais pensé ressentir autant de rapprochement avec un groupe par la lecture d’un livre. J’ai eu de la difficulté à m’y intéresser initialement, mais j’ai vite pris goût à ce manque de savoir qui s’estompait au fur et à mesure que je lisais. On y raconte l’arrivée des Blancs sur leur territoire, l’éducation blanche dans les écoles, l’introduction de l’alcool, la maltraitance policière, la gestion des habitations, et j’en passe. En bref, les autochtones ont vécu beaucoup plus de traumatismes que l’on ne pourrait croire. Ce qui m’a le plus troublée, c’est le chapitre 5 portant sur l’alcool (p. 101). L’autrice donne une explication linéaire de la chose : l’invention blanche est transmise aux autochtones, on les invite à s’intégrer aux bars (dans une section plus petite et malpropre). Ils vont devenir dépendants à sa consommation, pendant que le marchand va s’enrichir. Il s’amuse à les battre et à les dénoncer à la police, qui va les battre à son tour. C’est un vrai enfer, et les autochtones, maintenant accro, ne peuvent plus en sortir. C’est aujourd’hui un grand problème qui génère ensuite des complications telles que la violence conjugale au sein des familles. De nos jours, les Blancs se plaignent de cette surconsommation et traitent les autochtones d’alcooliques, mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que c’est entièrement de leur faute. Si les colons avaient gardé leurs coutumes blanches pour eux, les autochtones n’auraient jamais sombré dans cette horreur.
La lecture de ce livre m’a fait encore plus détester mes ancêtres. J’étais déjà au courant que les Blancs ont toujours été les pires colonisateurs, mais constater concrètement leur stupidité en en apprenant plus sur leurs actions fut dur à digérer. L’autrice répète à plusieurs reprises: «le Blanc a détruit notre culture», mais à mon avis, le simple fait d’avoir écrit ce roman est un petit pas vers sa résurrection. Je vois en cette femme une grande passionnée de ses origines et j’ai l’impression qu’elle pourrait aider beaucoup de jeunes autochtones à se retrouver par le partage des mots. Elle y raconte une tonne d’atrocités qui pourraient mettre en état de choc ses lecteurs, et généreraient des valeurs militantes chez les jeunes. Elle partage aussi beaucoup de coutumes et traditions qui pourraient inspirer certains à revenir à leurs sources. Par exemple, les passages où elle décrit les anciens modes de vie autochtones : «L’Indien ne se voit jamais utiliser un canot d’écorce qu’il a lui-même fabriqué, couvrir son habitation avec de l’écorce de bouleau ou de la peau de caribou et faire du feu directement sur le sol dans son habitation indienne.» (p. 151) On se plonge dans une réalité complètement opposée à la culture nord-américaine à laquelle nous sommes habitués aujourd’hui, et je trouve ça magnifique et inspirant. Malheureusement, la majorité des autochtones sont toujours dépendants du gouvernement : par exemple, ils se reposent sur les bons de nourritures fournis par celui-ci. Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que c’est justement lui le problème : c’est lui qui a interdit la chasse lorsque le gibier s’est fait plus rare, c’est lui qui a causé une famine. Ce fut un processus étalé sur une centaine d’années, ce qui le rendit imperceptible auprès du public. Je ne suis pas en mesure de parler pour une communauté qui ne m’est pas propre, mais je suis fière des autochtones qui se battent aujourd’hui pour retrouver leurs traditions ancestrales, car après cent ans d’ethnocide, ce n’est pas du gâteau.