Je dois reconnaître que je possédais très peu de connaissances sur le rap avant que nous l’étudions dans le cadre du cours Étique et politique, et qu’à ce jour, j’ai encore beaucoup à apprendre. Puisque cette forme d’art m’est peu familière, j’ai commencé par me pencher sur les principales façons dont elle m’avait été exposée, soit les goûts musicaux de mon frère et la culture populaire.

Mon frère écoutait énormément de Koriass pendant son adolescence. Encore aujourd’hui, ce sont ses chansons que nous chantons lorsque nous voyageons ensemble. Évidemment, l’œuvre de Koriass ne m’a aucunement exposé à la réalité, à la culture ou à l’histoire des personnes noires.
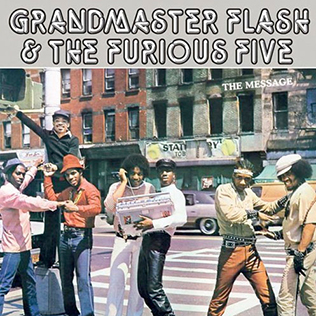
Il arrivait effectivement à mon frère d’écouter certaines chansons d’artistes afro-américains, notamment The message de Grandmaster Flash. Cependant, il ne portait aucune attention, justement, au message, donc il ne me l’a jamais retransmis. Puisque j’étais trop jeune pour faire des recherches par moi-même, c’est uniquement en classe que j’ai pu être exposée à la puissance de cette chanson. C’est justement sur la question du message que portera ma rédaction :
Je tenterai de cerner l’essence du message véhiculé par les rappeurs noirs, ainsi que son apport dans leur résistance
Afin de réactualiser ma connaissance du rap, j’ai commencé par identifier des artistes qui avaient des choses en commun avec moi, donc qui exposeraient un message que j’avais plus de chance de comprendre.


Un thème qui m’a beaucoup fait réfléchir lorsque nous l’avons abordé en classe a été celui de la violence. En effet, nous avons soulevé que les artistes noirs victimes d’oppression violente auraient pu afficher la violence dans leur rap comme forme de réponse et de lutte. Avant cet instant, je voyais la violence comme quelque chose de tout à fait contraire à l’art, sauf en tant que potentiel poétique. Ainsi, la conception de ce qu’est la violence dépend entièrement des expéricences de chacun.


Cette idée me semble bien exposée par le cratère qui se creuse entre Klô Pelgag et Childish Gambino lorsqu’un dit « Police be trippin’ now, yeah, this is America, guns in my area » et que l’autre répond « Je veux être libre comme la violence ».
Un autre élément qui m’a confronté à mes préjugés dans le rap a été l’esthétique de la richesse, parce que je ne suis pas fervante du capitalisme. Cependant, l’intervention de la rappeuse J-Kyll à 6:38 dans le documentaire Street rap « le son de la rue » m’a fait réaliser que puisque je ne viens pas d’un milieu défavorisé, je suis extrêment privilégiée d’avoir profité de ce système tout au long de ma vie. Étant donné que le capitalisme a été fondé sur l’exploitation des esclaves noirs, la réappropriation de l’image de la richesse dans le rap est tout à fait compréhensible.

Pour poursuivre dans l’idée de l’esthétique, un autre aspect de nos explorations en classe qui m’a beaucoup fait réfléchir a été celui du rapport entre le rap comme lutte pour une réussite personnelle ou comme une réussite collective, lorsque nous abordions la différence entre le libéralisme et le communautarisme, ainsi que l’intégrationnisme et le nationalisme.
– Rémi Laroche
Au cours de mes recherches, j’ai constaté qu’une majorité de chansons prône la réussite individuelle, et ce de plus en plus fréquemment à travers la lentille de la lutte identitaire.

Finalement, l’élément le plus révélateur de notre exploration du hip hop au niveau personnel et pour mon enquête a été celui de la théorie de James C. Scott quant à la théâtralisation du discours public et des sous-textes entre dominés et dominants entretiennent dans leurs « clans respectifs ». Avant de lire cet auteur, je restais complètement accrochée à l’idée que nous devions effacer le sous-texte afin de faire progresser la société.
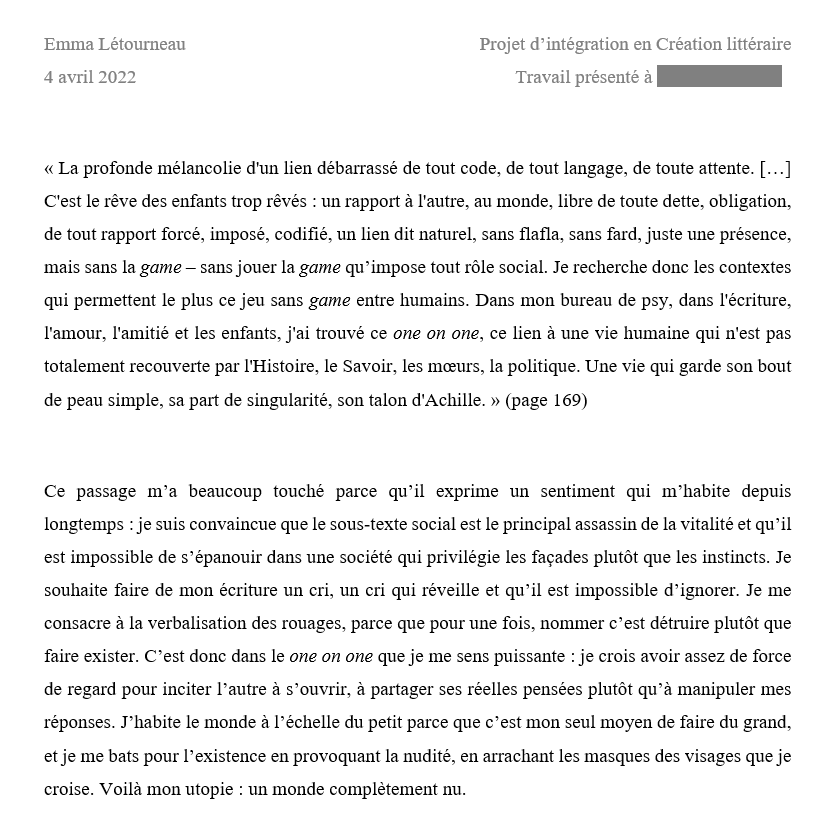
Voici d’ailleurs un texte qui précise mes pensées initales à ce sujet. Je l’ai rédigé dans le cadre d’un séminaire sur l’essai Ce que dit l’écorce de Nicolas Lévesque et Catherine Mavrikakis.
Je comprends maintenant qu’en tant que blanche, donc dominante, certains messages me sont intentionnellement dissimulés parce qu’il est trop dangereux pour les dominés de les rendre explicites.
– Connaisseur Ticaso
Rédaction :
La réception du message dans l’art du rap
La réception du message dans l’art du rap
« La vie est un équilibre fragile entre l’existence et la résistance. » – Kheira Chakor[1]
Toutes les connaissances qui m’ont été transmises lors de mon éducation collégiale m’ont permises d’enfin acquérir une certaine compréhension des rouages de la société qui m’entoure, ce qui m’amène à pouvoir réellement y prendre ma place de façon éclairée. J’ai retenu de ces apprentissages que l’avènement de la rationalité est un des éléments qui a le plus fortement modelé notre société, et que cela entraîne plusieurs problématiques : la survalorisation de la rationalité mène à la dévalorisation de l’expérience subjective, de l’instinct et de l’émotivité, ce qui nous coupe d’une part de notre nature et crée un sentiment assez généralisé de vide existentiel. Ma solution personnelle à ce sentiment a été de me dévouer à l’art, afin de redonner de la place et de l’importance à ma subjectivité à travers l’imaginaire et la création. Après avoir étudié l’art pendant les deux dernières années, j’ai développé la conviction que toute forme d’expression de soi constitue une forme d’art. Pourtant, pendant notre exploration du monde du Hip Hop, j’ai reconsidéré cette conviction, puisque je me suis retrouvée incapable de trouver que le message véhiculé dans la majorité des chansons de rap était artistique. Comme je suis incapable de me résoudre à croire que mon impression est fondée, je l’attribue à mon ignorance et à mon faible niveau de familiarité à cette forme artistique. L’envie de plonger complètement dans mon ignorance, de m’interroger et de me retrouver à l’envers de la médaille de mon travail sur les sorcières m’amène à générer la question d’enquête suivante : pourquoi est-ce que les messages véhiculés dans les chansons de rap me laissent dans l’incompréhension?
Avant le début de notre exploration du Hip Hop, je n’avais été exposée qu’à des artistes comme Koriass par l’entremise de mon frère ou Loco Locass par l’entremise de mes professeurs de français au secondaire. Je considère que ces artistes pratiquent une forme d’art complètement différente de celle du rap afro-américain, puisqu’elles n’ont pas la même culture. Comme je n’ai pas une culture afro-américaine, je n’ai jamais eu les référents nécessaires pour capter le message des quelques créateurs afro-américains que mon frère écoutait, notamment Grandmaster Flash et Jay-Z. Je constate donc que le rap se rend rarement jusqu’à moi, et que lorsqu’il y parvient, je ne comprends pas pleinement ce qu’il exprime et je n’ai pas d’emblée les référents nécessaires pour procéder à son interprétation.
En tant que créatrice, je me retrouve instinctivement confrontée à ma propre définition de l’art lorsque j’en consomme. Je considère d’abord qu’il est le terrain de jeu de l’anticonformisme et de la revendication ; je partage la conviction qu’il constitue un des moyens de réponse à la culture dominante les plus efficaces. Dans un contexte où la culture dominante la plus influente aujourd’hui est le capitalisme, instinctivement, j’ai tendance à penser que l’art doit être anticapitaliste. Pourtant, cette conception est en contradiction complète avec l’esprit du rap, puisqu’il est construit sur l’esthétique de la quête de force et de pouvoir, donc d’argent. A priori, j’étais rebutée par cette esthétique à cause de mon dégoût pour le capitalisme, mais aussi parce qu’en tant que femme, j’associe ces caractéristiques au système patriarcal, donc à mon oppresseur. Je comprends maintenant que dans le contexte d’oppression des personnes noires, les artistes fondateurs du rap tentaient de se réapproprier l’esthétique du dominant blanc afin d’échapper au statut de dominé : ils récupéraient un système économique dont l’établissement a été permis par leur exploitation.
Pour continuer dans la logique de l’art comme forme de revendication, je considère également qu’il symbolise l’idée de justice et de pacifisme. Pourtant, quand j’écoute du rap, je suis constamment happée par un sujet contraire à ces idées, soit la violence. Certes, il est possible d’utiliser la violence dans l’art en tant que métaphore ou de symbole, comme le fait Klô Pelgag en disant « je veux être libre comme la violence » dans sa chanson « Mélamine », ou encore pour la dénoncer de façon stylisée comme le fait Kendrick Lamar dans sa chanson « This Is America ». J’ai donc constaté que j’étais prête à accepter la violence sous forme poétique ou revendicatrice, mais que je n’arrivais pas à la considérer comme une forme de réappropriation d’expériences traumatiques. Selon moi, c’est fort probablement parce que je n’ai jamais vécu de violence aussi flagrante que la ségrégation raciale et que j’ai de la difficulté à être confrontée à elle directement : il me faut l’enjoliver ou la combattre pour y faire face.
Ensuite, pour moi l’art est également un moyen d’expression identitaire modelé par ma culture québécoise non-immigrante, par mon inscription à la génération montante, par mon statut de femme et par mon identité queer. Dans la mesure où le street rap est un milieu essentiellement homme, afro-américain et hétéronormatif, il constitue mon antipode. Il est donc normal que je ne m’y retrouve pas instantanément, mais il constitue bel et bien un moyen d’expression identitaire et je ne peux donc pas nier qu’il s’agit d’art.
Selon moi, toutes ces façons dont mon écoute du rap a été teintée dans ma vie me mènent à chercher un certain type de message dans l’art, à souhaiter que le rap explicite une volonté de changement et d’éveil des consciences pour que je l’accepte comme une « vraie » forme d’art.
À travers les écrits de James C. Scott, mon enquête sur le Hip Hop m’a fait comprendre que le message du rap constitue un sous-texte, un dialogue entre individus d’un groupe dominé, et que comme je m’inscris malgré moi dans le groupe des dominants, je n’ai pas accès à ce message parce qu’on me le dissimule. Cependant, je constate que le fait d’être coupée d’une partie du discours me mène à développer une certaine frustration, parce que j’ai l’impression ou la préconception que je dois comprendre pour aider. En effet, j’ai longtemps entretenu la conviction que les problèmes d’oppression disparaitraient si nous pouvions effacer le sous-texte entre dominants et dominés, nous donner la chance d’entrer en contact et d’exposer les faits. Je croyais que ce serait la seule façon de faire avancer la cause et d’entrainer le progrès. Ma lecture d’Angela Davis m’a permis de me rendre compte que c’est parce que je n’étais pas consciente de l’ampleur de la dangerosité d’une telle démarche pour les dominés que j’ai pu me permettre d’entretenir cette utopie : « mon chagrin et ma colère s’alourdissaient de peur. Une peur pure et simple, si puissante et si élémentaire que la seule chose à laquelle je pus la comparer était le sentiment d’engloutissement que je ressentais lorsque enfant, on me laissait dans le noir. Cette chose indescriptible, monstrueuse, était dans mon dos, elle ne me touchait jamais mais elle était toujours prête à l’attaque. »[2]
À travers mon étude du rap, j’ai compris que cette forme d’art comprend toujours une forme de lutte, même si elle ne prend pas la forme de revendication explicite à laquelle je m’attends : il s’agit d’une lutte individuelle à travers l’expression. L’expression individuelle peut être une façon de lutter pour son bienêtre personnel, de se libérer d’un poids ou d’exprimer une douleur pour tenter de l’atténuer. Les discours qu’on retrouve dans le rap sont donc souvent très subjectifs : ils se basent sur les expériences individuelles plutôt qu’universelles à travers des référents que seuls les auteurs peuvent comprendre complètement. Cependant, c’est ce flou qui permet à celui qui écoute d’interpréter le message à sa façon et d’y transposer ses propres expériences, d’y insérer sa propre subjectivité. Ainsi, par l’expression d’un message individuel, on peut parvenir à rallier plusieurs individus et créer un sens de lutte collective. Dans un contexte comme celui de la ségrégation raciale, le seul fait de continuer d’exister et de prendre la parole constitue un acte résistance. Un bon exemple de ce type de résistance individuelle au niveau identitaire est le rappeur Lil Nas X : il n’a pas aucune chanson qui appelle à dénoncer l’homophobie, mais en exposant son identité queer sans gêne, il contribue à agrandir l’ouverture d’esprit dans le milieu du rap aux États-Unis. Au Québec, son équivalent serait la rappeuse Calamine : les références au lesbianisme dans ses chansons sont très opaques pour ceux qui ne font pas partie de la communauté queer, mais le fait qu’elles existent constitue une lutte. La lutte réside donc dans la prise de parole plutôt que dans la reconnaissance du message de cette parole.
Mon enquête me permet de conclure que le message des chansons de rap ne m’apparait pas de façon explicite parce que qu’il n’a pas besoin de l’être et qu’il en ressort plus puissant ainsi. Par contre, pour que cette efficacité demeure, la société doit absolument réserver une place dans l’espace public pour cette forme d’art : la voix des artistes issus de communautés oppressées doivent être représentées et entendues même si elles ne sont pas comprises. Les institutions culturelles et scolaires devraient donc augmenter la promotion des formes de cultures divergentes afin que la société développe une meilleure écoute. Je suis persuadée que le rap est assez puissant pour toucher la sensibilité d’une majorité d’individus et que nous avons tout à gagner de nous ouvrir à lui, même dans l’incompréhension. Malheureusement, je crois que mon besoin de compréhension du message du rap est un produit de la survalorisation de la rationalité que j’évoquais au début de ma rédaction, mais continuer à en écouter pourra certainement m’aider à me défaire de ce besoin.
[1] https://citations.ouest-france.fr/citation-kheira-chakor/vie-equilibre-fragile-entre-existence-132625.html