REPRÉSENTATION : Nos leçons m’ont fait réaliser que ma conception mentale de la sorcière était complètement vide de lien avec leur chasse, leur torture et leur mort. C’est un peu comme si tout élément historique les concernant avait été effacé de ma conscience, pour ne laisser place qu’à la figure imaginaire. La banalisation de cette figure a été tellement efficace que même si je suis une féministe engagée et avide de changement, j’ai été aveugle à une infinité de violence.
Mona Chollet – Sorcières, La puissance invaincue des femmes
« Il m’a fallu un temps étonnamment long pour mesurer le malentendu que recouvraient la débauche de fantaisie, l’imagerie d’héroïne aux superpouvoirs associées aux sorcières dans les productions culturelles qui m’entouraient. Pour comprendre que, avant de devenir un stimulant pour l’imagination ou un titre honorifique, le mot « sorcière » avait été la pire marque d’infamie, l’imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes. »
Comme nous avons beaucoup abordé la représentation de la sorcière dans la littérature, les films et les séries télévisées en classe, j’ai voulu enquêter sur un autre média : la musique. Analyser la musique me permet d’évaluer l’état de la compréhension de la figure de la sorcière dans la société, ainsi que les informations que les gens ont reçues sur cette figure au fil des ans. Mes recherches m’ont apprises que l’entrée de la figure de la sorcière dans la musique américaine dans les années 60-70 est rattachée à l’éclosion de certaines luttes féministes :
Maryse Sullivan – Entre fiction et histoire : la construction de la figure de la sorcière dans la littérature contemporaine
« Dans la décennie 1960, la sorcellerie et une fascination pour les sciences occultes infiltrent également la culture populaire par le biais de la musique rock et la contre-culture. […] Ce succès du renouveau occulte a tiré profit d’autres circonstances de l’époque qui ont favorisé sa floraison. Notons, par exemple, la montée des mouvements sociaux pour les droits civiques et des femmes »
Ce fait m’a poussé à me demander si toutes les chansons de cette époque qui utilisent l’imaginaire de la sorcière tenaient également des propos féministes, et comment cela a évolué au fil du temps. C’est ainsi que la question de mon enquête s’est dessinée :
Est-ce que la représentation de la sorcière en musique contribue à la banalisation de la figure ou à la résistance féministe?
MUSIQUE : Afin de réaliser mon enquête, j’ai analysé les paroles 20 chansons qui présentent une figure de sorcière et déterminé si elles avaient une portée féministe. Les 10 premières chansons sont interprétées par des femmes et les autres sont interprétées par des hommes. Les titres en gras sont ceux de chansons que j’ai jugées féministes.
- Sorcières – Pomme et Klô Pelgag – 2019
- Une sorcière comme les autres – Anne Sylvestre et Pauline Julien – 1975
- Sorcière – Mélodie Spear – 2021
- Waking the witch – Kate Bush – 1985
- A little wicked – Valerie Broussard – 2019
- Witches – Alice Phoebe Lou – 2020
- Rhiannon – Fleetwood Mac – 1975
- Black magic – Little Mix – 2015
- Witch The Bird and the Bee – 2009
- Witchcraft in the air – Bettye LaVette – 1962
- Un trou dans les nuages – Michel Rivard – 1987
- All of Them Witches – 3 Inches of Blood – 2009
- American Witch – Rob Zombie – 2006
- Sorcières – Jean-Leloup – 1989
- La sorcière – Daniel Lavoie et Garou – 1998
- My Girlfriend is a Witch – October Country -1968
- Child Of The Moon – The Rolling stones – 1968
- Witchy Woman – the Eagles – 1972
- Wicked Old Witch – John Fogerty – 2004
- Wild Witch Lady – Donovan – 1973
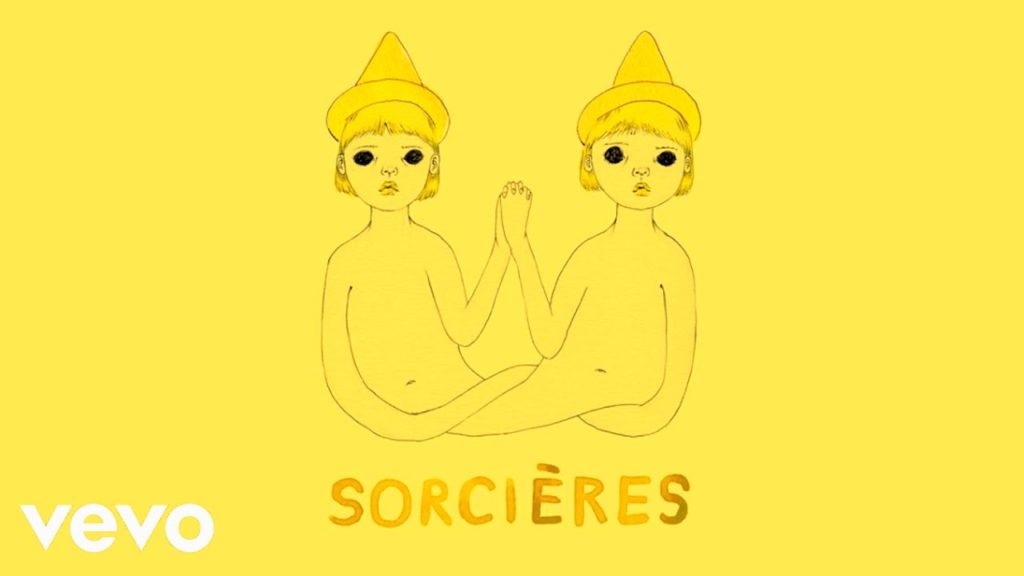
Une sorcière pas comme les autres chantée par un choeur de femmes :
TEMPÊTE D’IDÉE SUITE À L’ANALYSE DES CHANSONS :
- Une grande proportion des chansons associent la figure de la sorcière au désir, la femme reste encore une fois prisonnière du regard de l’homme, même dans les chansons écrites par des femmes.
- Beaucoup de chansons utilisent l’imaginaire des sorcières sans aucune référence à leur chasse, il y a effacement total de l’histoire, ce qui laisse place complète à la banalisation.
- Les chansons féministes étaient féministe parce qu’elles comprenaient : un appel à la solidarité et l’union des femmes, une dénonciation explicite de la violence, un rappel des faits historiques de l’inquisition, une réappropriation de l’indépendance, une affirmation de l’identité femme qui utilise les symboles de la sorcière, une dénonciation de toutes les formes de répressions des femmes ou un appel au pouvoir.
- Même dans les chansons féministes qui utilisent la figure à bon escient, peut-il vraiment y avoir résistance et efficacité du message, impact, si le public n’est pas pleinement conscient de l’ampleur du problème, de sa complexité, de la multitude d’impact sur nos moyens de pensées et d’agir actuels?
- Les deux messages (féministes et non féministes) sont présents, mais est-ce qu’ils ont la même portée, la même efficacité? Quelle est l’influence du style, du moyen de diffusion et du public cible sur l’écoute?
- Est-ce qu’il est trop tôt pour se réapproprier la sorcière? Est-ce qu’on comprends assez bien son histoire et toutes ses influences?
- Est-ce que la musique est un support assez large pour une la cause féministe, assez solide? Peut-on résister en 3 minutes? Écoutons-nous vraiment si la musique est trop belle? Voulons-nous être éveillés par la musique? Moi oui, mais la dame qui s’en va travailler, qui écoute la pop dans le trafic, a-t-elle le temps de remettre son existence en question?
AUTRES RESSOURCES :
RÉDACTION
Féminisme et représentation des sorcières en musique
« Mais il ne lui suffit pas d’avoir été livrée à ses bourreaux, il faut encore que dans une vie posthume elle soit abandonnée à d’autres, à tous ceux qui, trouvant en elle une source inépuisable de fantastique, la jettent en pâture aux amateurs d’émotions fortes. »
- Colette Arnould, Histoire de la sorcellerie
L’humain est doté d’une fascination totale pour le fantastique et l’exploration de l’imaginaire, et il se sert souvent de ces éléments pour créer des sources de divertissement. Une des figures imaginaires les plus populaires est sans doute celle de la sorcière. En effet, la figure de la sorcière est présente partout dans les médias de masse, à travers des livres pour enfants comme Sacrées sorcières de Roald Dahl, des films comme Maléfique ou La légende de Blair, des comédies musicales comme Wicked ou encore des séries télévisées comme Ma sorcière bien aimée. Ainsi, dès notre plus jeune âge et tout au long de notre vie, on peut baigner dans l’imaginaire de la sorcière, cette femme vieille, laide et solitaire qui possède de sombres pouvoirs. Pourtant, une très faible proportion de l’espace culturel sert à dépeindre la réalité des sorcières à l’époque de l’inquisition, le récit de procès, de torture et de mort de plus de 50 000 femmes innocentes. Cette totale banalisation de la figure de la sorcière est inquiétante, car une société comme la nôtre qui vise l’égalité des genres ne peut en aucun cas se permettre d’effacer une des plus grandes histoires de violence faite aux femmes, puisque cela empêche d’identifier et de freiner les répercussions actuelles de tels événements : « Pourra-t-on longtemps parler en toute cohérence de parité sans soulever la question de la politique de représentation de l’image de la femme dans les médias ? » Il faut noter que certaines féministes conscientes de cette facette de l’histoire se réapproprient l’image de la sorcière et l’utilisent pour donner du poids à leurs luttes politiques. Il est alors intéressant de se pencher sur la représentation de la figure de la sorcière en musique, car cette forme d’art peut servir à la fois en média de masse et d’outil de résistance politique. Est-ce que la représentation de la sorcière en musique contribue à la banalisation de la figure ou à la résistance féministe ?
Afin de répondre à mon questionnement, j’ai étudié les paroles de vingt chansons qui présentent d’une façon ou d’une autre la figure de la sorcière. Mon travail consistait à examiner l’utilisation de la figure et à identifier le message transmis aux auditeurs, à l’imaginaire collectif, à la société. Ces chansons ont été écrites à des époques variées et dans des styles musicaux qui le sont tout autant. La moitié d’entre-elles sont interprétées par des femmes. Des vingt œuvres, six sont franco-québécoises et les autres sont anglophones. Au terme de mes analyses, j’ai constaté que seulement huit des vingt chansons avaient une portée féministe claire, que la moitié de celles-ci était franco-québécoises. Seulement trois des huit chansons féministes étaient interprétées par des hommes. Les éléments récurrents qui m’ont permis d’identifier les propos féministes dans les chansons ont été l’appel à la solidarité et l’union des femmes, la dénonciation explicite de la violence, le rappel des faits historiques de l’inquisition, la dénonciation des autres formes de répressions des femmes, la réappropriation de l’indépendance et du pouvoir ainsi que l’affirmation de la singularité des femmes. J’ai observé que les chansons sans portées féministes avaient plusieurs éléments communs, notamment l’absence totale de mention de l’inquisition et le fait que la sorcière reste prisonnière du regard de l’homme. En effet, elle fait figure de tentation, de pêché, de désir interdit. Les chansons Black Magic de Little Mix et Witchcraft in the air de Bettye LaVette parlent d’ailleurs de femmes qui utilisent leur magie pour forcer les hommes à tomber amoureux d’elles. Je vois dans ces chansons la preuve que des femmes peuvent récupérer l’image de la sorcière sans aucune portée féministe, ce qui confirme malheureusement mon impression qu’il y a de sérieuses lacunes dans la mémoire collective et la connaissance de l’histoire des femmes, et que l’espace public est endormi.
Moi-même je ne connaissais pratiquement rien de l’histoire de la chasse aux sorcières. En fait, j’ai entendu le mot « inquisiton » des dizaines de fois, mais je n’en ai jamais connu la signification avant d’être initiée aux œuvres de Catherine Clément et d’Armelle Le bras-Choppard. Pourtant, en tant que féministe bruyante et assumée, je croyais avoir une excellente connaissance de l’histoire des femmes. Monat Chollet verbalise exactement la réalisation que j’ai eu dans son ouvrage Sorcières: La puissance invaincue des femmes : « Il m’a fallu un temps étonnamment long […] [pour] comprendre que, avant de devenir un stimulant pour l’imagination ou un titre honorifique, le mot “sorcière” avait été la pire marque d’infamie, l’imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes. »
Mon étude me porte à croire que la réappropriation de la figure de la sorcière en musique de manière féministe ne peut pas servir de résistance si la population n’est pas au courant des faits qui concernent cette figure, puisque le message véhiculé par ces chansons n’est pas réellement entendu. De plus, un public inconscient de l’ampleur de l’horreur de l’inquisition et de la complexité de ses répercussions sur nos moyens de pensées et d’agir ne peut pas le devenir seulement après avoir écouté une chanson. Si la chanson est un excellement moyen de rassembler les gens conscientisés, il ne s’agit pas d’un support assez solide, assez consistent pour servir de moyen d’éducation à ceux qui ne le sont pas. Ainsi, il est peut-être trop tôt pour se réapproprier la figure de la sorcière de façon générale ; elle n’est pas exploitée en toute connaissance de cause.
Je conclu de mon étude musicale de la représentation des sorcières que le système d’éducation se doit de mettre de l’avant l’histoire des femmes et d’être clair dans l’ampleur de leur répression pour que le féminisme puisse continuer de progresser. Raconter l’histoire de la chasse aux sorcières permettrait d’exposer le sexisme institutionnel, les mécanismes de violence et le cycle de banalisation. Avec la vague de féminicides connue au Québec en 2021, il y a résurgence du combat contre la violence faite aux femmes. Bien que cette réalité soit tragique, c’est un excellent moyen d’introduire les gens aux formes de violences antérieures dans l’histoire. Il s’agira peut-être de la porte d’entrée qu’il manquait pour bien éduquer le public sur l’histoire des sorcières.
1 121 mots